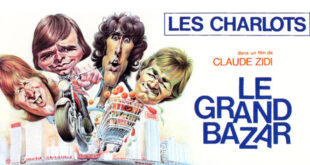« Le rire, c’est l’oxygène de l’esprit. Ça entretient des décharges d’adrénaline, épatantes pour la santé. On rit d’abord pour soi. Comment faire rire les autres, si on n’a pas envie de s’amuser soi-même ? Quand je m’arrête, ma tension tombe. C’est la chute. Je suis donc condamné à faire rire en permanence. » Tels sont les propos tenus par Jean Poiret, aux dernières lueurs de son existence. Cette philosophie, il l’appliqua tout au long de son parcours, jouant notamment Molière à tout juste 20 ans.
 Sa confrontation en 1952 avec le jeune comédien Michel Serrault, dans le sillage d’une audition, le stimule encore davantage. Une séduction réciproque s’instaure. Serrault précise : « Ce qui m’a frappé à notre première rencontre, c’est sa distinction. Rien de hautain ou de distant, bien au contraire, mais un charme qui était une invitation à la gaieté. » Émerge alors l’idée d’un duo, lequel écume très vite les meilleures salles parisiennes avec une série de sketches détonants, dont Les Antiquaires, un de leurs plus grands tubes, inspiré par un véritable couple d’hommes issu de leur entourage. Dans le même temps, ils assistent à une représentation de L’Escalier, pièce écrite par Charles Dyer (1966), avec Paul Meurisse et Daniel Ivernel. Il y est encore question d’homosexualité – ainsi que de travestissement – mais abordée ici de façon relativement dramatique. En réaction, Jean Poiret perçoit d’emblée le potentiel fantaisiste d’une conjoncture plus ou moins similaire, et consigne ses pensées sur un carnet.
Sa confrontation en 1952 avec le jeune comédien Michel Serrault, dans le sillage d’une audition, le stimule encore davantage. Une séduction réciproque s’instaure. Serrault précise : « Ce qui m’a frappé à notre première rencontre, c’est sa distinction. Rien de hautain ou de distant, bien au contraire, mais un charme qui était une invitation à la gaieté. » Émerge alors l’idée d’un duo, lequel écume très vite les meilleures salles parisiennes avec une série de sketches détonants, dont Les Antiquaires, un de leurs plus grands tubes, inspiré par un véritable couple d’hommes issu de leur entourage. Dans le même temps, ils assistent à une représentation de L’Escalier, pièce écrite par Charles Dyer (1966), avec Paul Meurisse et Daniel Ivernel. Il y est encore question d’homosexualité – ainsi que de travestissement – mais abordée ici de façon relativement dramatique. En réaction, Jean Poiret perçoit d’emblée le potentiel fantaisiste d’une conjoncture plus ou moins similaire, et consigne ses pensées sur un carnet.
Préalablement, au cours des années 1960, Poiret et Serrault coécrivent et tiennent le haut de l’affiche de trois comédies théâtrales : Sacré Léonard, Opération Lagrelèche et Les Grosses têtes, tout en s’imposant progressivement au cinéma : après Assassins et voleurs signé Sacha Guitry en 1957, on les croise régulièrement dans des œuvres à la qualité diverse, du Naïf aux quarante enfants de Philippe Agostini à Ces Messieurs de la famille de Raoul André, en passant par Nina de Jean Boyer, Oh ! Qué mambo de John Berry, Vous n’avez rien à déclarer ? de Clément Duhour, Ma Femme est une panthère de Raymond Bailly et Jaloux comme un tigre de Darry Cowl.
LA CAGE AUX FOLLES AU THÉÂTRE
À l’aube des années 1970, Jean Poiret amorce une carrière d’auteur solo, avec Douce-amère. Un texte plus personnel, à la fois cocasse et mélancolique. Hélas, le public ne suit qu’à demi-pas. Poiret se cherche et galère quelque peu. Son salut, il le doit à Jean-Michel Rouzière, directeur du théâtre du Palais-Royal. En quête de renouveau pour sa programmation, il sollicite son ami Jean, afin de connaître ses éventuels desseins. L’un d’eux reprend donc le thème des Antiquaires et de L’Escalier, avec toutefois de subtils réagencements. Si l’auteur en conserve le fondement (un ménage gay), il nous plonge dans un tout autre univers : un de ses protagonistes, Georges (Poiret), est à la tête d’un cabaret, et l’autre, Albin (Serrault), s’y produit, sous le pseudonyme de Zaza Napoli. Une existence a priori paisible, jusqu’au jour où « leur » fils annonce vouloir se marier, avec une femme, et dont le père est en plus un député aux positions politiques extrêmement rétrogrades. Le début des ennuis…
Selon Pierre Mondy, « Le célèbre titre n’existe pas encore, mais Rouzière a déjà saisi, avec sa paire d’antennes, l’intérêt de cette histoire. Il tanne Jean pour qu’il finisse de l’écrire. Le sujet est délicat, on est sans arrêt sur le fil du rasoir, Poiret ne veut pas risquer de tomber dans le mauvais goût ou la caricature blessante. Mais quand il découvre le texte définitif, Jean-Michel est fou de joie : « Imaginer des gens atypiques dans une situation normale, voilà le coup de génie ! »
Le grand retour de Poiret et Serrault est, dès lors, annoncé. Et il convient d’être à la hauteur. Pour ce faire, on leur adjoint la quintessence à chaque poste : André Levasseur pour les décors et les costumes, Pierre Mondy à la mise en scène. Reste un point délicat à aborder. Rouzière s’interroge en effet sérieusement sur le titre envisagé, La Cage aux folles. Pour lui, la provocation est trop forte. Il y a des limites à ne pas franchir. Poiret persiste cependant : « Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise… Comment voulez-vous qu’on appelle ça ? Prout ? » Fort heureusement, il n’en sera rien et l’auteur obtient gain de cause.
 La Première est fixée au 1 février 1973. D’ici là, il convient de mettre la pièce sur les rails. Tout ne fonctionne pas encore admirablement et, jusqu’au bout, Jean Poiret affine son propos : « À la répétition prévue pour les photographes, raconte Mondy, ils sont au moins une cinquantaine ! Pendant la scène « culte » où Jean apprend à Michel à beurrer sa biscotte « comme un homme », on n’entend pas un déclic, pas un flash. Les photographes ont posé leurs appareils, ils écoutent, pliés en deux ! Au quatrième tableau, Jean entre vêtu en femme. Déshabillé rose, boa en guise d’écharpe, pendentifs, etc. Et là, le silence. Plus de rires, et à chacune de ses apparitions, même topo. Apparemment, quelque chose ne colle pas dans le personnage de Georges. Autant Serrault est pleinement Zaza Napoli, épanoui en robe rouge pailletée et chaussures à talons hauts, autant Poiret habillé en femme dérange. Sans public ou regards extérieurs, nous ne nous en sommes pas rendu compte. Réunion de crise au théâtre. Il faut repenser son allure générale et même revoir toute la fin du personnage. À partir de ce moment-là, Jean va réécrire son rôle, parfois chez moi, toute la nuit, jusqu’à sept heures du matin, gommant ce qui faisait référence à son apparence féminine et lui donnant une nouvelle personnalité. Le quatrième tableau est modifié pendant les représentations. Navigation à vue ! Un spectateur venu tous les soirs au théâtre n’aurait jamais vu la même fin, la troupe « raccordant » l’après-midi. Dans ces heures difficiles, Jean-Michel est là, il nous soutient : il accepte sans broncher que l’on coupe vingt minutes de la pièce sacrifiant, de facto, des milliers de francs de costumes qui ne servent plus à rien. »
La Première est fixée au 1 février 1973. D’ici là, il convient de mettre la pièce sur les rails. Tout ne fonctionne pas encore admirablement et, jusqu’au bout, Jean Poiret affine son propos : « À la répétition prévue pour les photographes, raconte Mondy, ils sont au moins une cinquantaine ! Pendant la scène « culte » où Jean apprend à Michel à beurrer sa biscotte « comme un homme », on n’entend pas un déclic, pas un flash. Les photographes ont posé leurs appareils, ils écoutent, pliés en deux ! Au quatrième tableau, Jean entre vêtu en femme. Déshabillé rose, boa en guise d’écharpe, pendentifs, etc. Et là, le silence. Plus de rires, et à chacune de ses apparitions, même topo. Apparemment, quelque chose ne colle pas dans le personnage de Georges. Autant Serrault est pleinement Zaza Napoli, épanoui en robe rouge pailletée et chaussures à talons hauts, autant Poiret habillé en femme dérange. Sans public ou regards extérieurs, nous ne nous en sommes pas rendu compte. Réunion de crise au théâtre. Il faut repenser son allure générale et même revoir toute la fin du personnage. À partir de ce moment-là, Jean va réécrire son rôle, parfois chez moi, toute la nuit, jusqu’à sept heures du matin, gommant ce qui faisait référence à son apparence féminine et lui donnant une nouvelle personnalité. Le quatrième tableau est modifié pendant les représentations. Navigation à vue ! Un spectateur venu tous les soirs au théâtre n’aurait jamais vu la même fin, la troupe « raccordant » l’après-midi. Dans ces heures difficiles, Jean-Michel est là, il nous soutient : il accepte sans broncher que l’on coupe vingt minutes de la pièce sacrifiant, de facto, des milliers de francs de costumes qui ne servent plus à rien. »
 De la même manière, Serrault travaille au détail près son interprétation : « Il n’était pas question de se vautrer dans une farce épaisse et vulgaire. J’avais à nourrir d’humanité ma chère Zaza, et à la jouer suivant les plus nobles principes des grands clowns. Et il est vrai que je me suis souvent souvenu d’Albert Fratellini qui m’avait dit, en frappant son cœur : « Ça doit venir de là. Pas de la perruque et du nez rouge. » Atteindre le délicat point d’équilibre entre le rire et l’émotion permettait de soulevait le voile : ce qui se cachait sous le rire, c’était bien le début de la détresse d’un couple. La Cage me comblait à cet égard, puisque, par le truchement du divertissement, de la gratuité, c’est-à-dire du rire pour le rire, la pièce prouvait qu’on pouvait être profond et grave, et surtout que l’ennui au théâtre n’était pas un mal nécessaire. Mais il fallait être vigilant, rester dans la comédie et la drôlerie, ne pas figer le rire par un arrière-goût de drame. »
De la même manière, Serrault travaille au détail près son interprétation : « Il n’était pas question de se vautrer dans une farce épaisse et vulgaire. J’avais à nourrir d’humanité ma chère Zaza, et à la jouer suivant les plus nobles principes des grands clowns. Et il est vrai que je me suis souvent souvenu d’Albert Fratellini qui m’avait dit, en frappant son cœur : « Ça doit venir de là. Pas de la perruque et du nez rouge. » Atteindre le délicat point d’équilibre entre le rire et l’émotion permettait de soulevait le voile : ce qui se cachait sous le rire, c’était bien le début de la détresse d’un couple. La Cage me comblait à cet égard, puisque, par le truchement du divertissement, de la gratuité, c’est-à-dire du rire pour le rire, la pièce prouvait qu’on pouvait être profond et grave, et surtout que l’ennui au théâtre n’était pas un mal nécessaire. Mais il fallait être vigilant, rester dans la comédie et la drôlerie, ne pas figer le rire par un arrière-goût de drame. »
 Au bout du compte, La Cage aux folles séduit en masse. Le Tout-Paris d’abord, puis bien au-delà, accourt pour rire – et applaudir – les extravagantes tribulations de ce couple hors du commun. La presse, dans son éminente largesse, se rallie au public et délivre des papiers dithyrambiques. Pierre Marcabru dans Le Figaro ouvre le bal et proclame : « Le triomphe du burlesque ! On glisse de fou rire en fou rire en un mouvement qui s’accélère. » Le Canard Enchaîné, sous la plume de Philippe Tesson, prétend pour sa part que « Le génie de Poiret est de n’avoir pas succombé à la tentation d’une caricature des mœurs. Il a inventé une intrigue absolument démente et il s’en donne à cœur joie pour greffer là-dessus les situations les plus extrêmes, les plus culottées, les moins soutenables ». Georges Lerminier du Parisien enfonce le clou : « Jean Poiret a du tact. Mieux : de l’esprit, un sens aigu du théâtre, une audace calculée dans la manière de conduire ses scènes et son dialogue, une grande perspicacité psychologique ». Et François Chalais d’ajouter, sur Europe 1, en faveur de la vedette phare : « Le numéro de Serrault appartient désormais à l’histoire du théâtre. »
Au bout du compte, La Cage aux folles séduit en masse. Le Tout-Paris d’abord, puis bien au-delà, accourt pour rire – et applaudir – les extravagantes tribulations de ce couple hors du commun. La presse, dans son éminente largesse, se rallie au public et délivre des papiers dithyrambiques. Pierre Marcabru dans Le Figaro ouvre le bal et proclame : « Le triomphe du burlesque ! On glisse de fou rire en fou rire en un mouvement qui s’accélère. » Le Canard Enchaîné, sous la plume de Philippe Tesson, prétend pour sa part que « Le génie de Poiret est de n’avoir pas succombé à la tentation d’une caricature des mœurs. Il a inventé une intrigue absolument démente et il s’en donne à cœur joie pour greffer là-dessus les situations les plus extrêmes, les plus culottées, les moins soutenables ». Georges Lerminier du Parisien enfonce le clou : « Jean Poiret a du tact. Mieux : de l’esprit, un sens aigu du théâtre, une audace calculée dans la manière de conduire ses scènes et son dialogue, une grande perspicacité psychologique ». Et François Chalais d’ajouter, sur Europe 1, en faveur de la vedette phare : « Le numéro de Serrault appartient désormais à l’histoire du théâtre. »
 La machine est lancée. La Cage aux folles se joue à guichets fermés cinq années consécutives. Certains, même, reviennent voir la pièce, seuls ou en famille, et on installe des rehausseurs pour les plus jeunes. Que l’on ait 7 ou 77 ans, on pleure littéralement de rire, les deux vedettes ajoutant parfois une heure de délires à leur numéro initial. L’amusement est tel, qu’il se régénère en permanence, dans la salle comme sur scène : « Jean « embarque » littéralement l’improvisation et cet immense Auguste qu’est Michel suit formidablement parce qu’ils se connaissent par cœur, confirme Pierre Mondy. Les deux revisitent leurs textes, prolongent, étirent, inventent sans se concerter. Et ils retombent toujours sur leurs pattes… »
La machine est lancée. La Cage aux folles se joue à guichets fermés cinq années consécutives. Certains, même, reviennent voir la pièce, seuls ou en famille, et on installe des rehausseurs pour les plus jeunes. Que l’on ait 7 ou 77 ans, on pleure littéralement de rire, les deux vedettes ajoutant parfois une heure de délires à leur numéro initial. L’amusement est tel, qu’il se régénère en permanence, dans la salle comme sur scène : « Jean « embarque » littéralement l’improvisation et cet immense Auguste qu’est Michel suit formidablement parce qu’ils se connaissent par cœur, confirme Pierre Mondy. Les deux revisitent leurs textes, prolongent, étirent, inventent sans se concerter. Et ils retombent toujours sur leurs pattes… »
Un exploit d’autant plus saisissant que Michel Serrault affronte en parallèle un terrible drame : la perte de sa fille Caroline, à l’âge de 19 ans, victime d’un accident de la route. Mais l’acteur ne lâche rien et monte chaque soir sur les planches : « Un homme de la terre, dit-il, serait allé cultiver son champ, soigner ses bêtes. Je suis allé jouer. J’entendais des salles que mes extravagances faisaient rire, mais, à chaque sortie de scène, je m’effondrais dans les bras d’un régisseur ami pour pleurer. Et je rentrais à nouveau sous les lumières. » Mondy assiste, impuissant, à sa souffrance : « Jamais il n’évoque son deuil, il ne dit rien, pas un mot. Dix fois, vingt fois par jour, on voudrait l’aider, lui demander si ça va, ce qu’on peut faire pour atténuer sa douleur. Son visage reste impassible, il est comme enfermé en lui-même. Parfois, sa voix tremble un peu, alors il tousse un bon coup, il vocalise comme un chanteur d’opéra et il replonge dans Zaza. Nous rions, mais tous, nous ne pensons qu’à ça… Le premier soir de la reprise, quand Michel, de dos avec sa perruque flamboyante, tourne son visage pailleté vers le public en poussant un cri aigu et joyeux, j’ai un coup à l’estomac. Comment fait-il ? »
Après mille représentations, Jean Poiret bat en retraite. Il est successivement remplacé par Henri Garcin, Michel Roux, Jacques Sereys et Pierre Mondy. Michel Serrault l’imite, cinq cent dates plus tard, et laisse alors les frasques de son personnage au comédien belge Jean-Jacques. Entre-temps, aucune représentation n’a été – malheureusement – captée. Il existe cependant bien plus que les rares extraits diffusés ici ou là. Preuve en est, le site INA madelen propose de visionner soixante-cinq minutes de la pièce avec Poiret et Serrault. Un document précieux et incontournable.
LA CAGE AUX FOLLES AU CINÉMA
La Cage aux folles (Édouard Molinaro, 1978)
En marge, une transposition sur grand écran est rapidement évoquée. Et un producteur en particulier s’intéresse de très près à l’idée. Son blase : Fechner. Christian Fechner. Il est à ce point motivé par le projet qu’il est prêt à couvrir d’or Jean Poiret. Mais ce dernier rechigne : « Si c’est pour faire Les Dégourdis de la 11ème ou Deux Folles sous les drapeaux, ce n’est pas la peine… » explique-t-il, faisant référence aux films joués par Les Charlots avec lesquels Fechner a débuté. Finalement, c’est à un producteur italien que Poiret cède ses droits : Marcello Danon. On lui doit La Salamandre d’or (1967), O.S.S. 117 se déchaîne ! (1963), Pas de roses pour O.S.S. 117 (1968), Sous le signe de Monte-Cristo (1968) ou encore La Tarentule au ventre noire (1971). Seulement, cette entreprise transalpine, aussi heureuse soit-elle, a un coût. Et pas des moindres. Une distribution en partie italienne est négociée. Michel Serrault étant irremplaçable dans le rôle de Zaza, Jean Poiret abandonne son rôle, au grand dam de son partenaire : « Ça me convient très bien ! me dit Jean, qui me voyait triste pour lui. Je t’assure que je n’ai pas de regrets ! Et alors… en gros plan… tu vas être encore plus ravissante ! »
 Une fois ce transfert digéré, l’heure est à la réécriture. Il faut faire de la pièce un vrai scénario. Lourde tâche. Et Jean Poiret n’y parvient pas. Il sombre même dans une profonde dépression. Sur les conseils d’Édouard Molinaro, choisi pour la réalisation (le nom de Jean-Pierre Mocky avait aussi été évoqué), Marcello Danon appelle à la rescousse un maître de la plume, l’inestimable Francis Veber, à la carrière déjà plus qu’exceptionnelle (Le Grand Blond avec une chaussure noire, L’Emmerdeur, Le Téléphone rose, Peur sur la ville, Coup de tête, etc.). L’auteur comprend parfaitement le problème : « Il faut couper, attaquer la pièce à la hache, pour l’amener au format d’un film. Certaines situations dont on sait qu’elles sont drôles sont sacrifiées et les rires qu’elles ont provoqués sur scène viennent mourir dans la corbeille à papier. » Fervent admirateur de Poiret, Veber accepte immanquablement de relever le défi et y parvient haut la main, n’en déplaise à Danon qui, au bout du compte, estime qu’il n’y pas assez de femmes dans son script : « Il faisait partie de la vieille école de producteurs, explique Francis Veber, ceux qui pensaient que, pour assurer le succès d’un film, il fallait quelques filles déshabillées, un chien d’aveugle et un enfant abandonné. C’était trop difficile à caser dans La Cage aux folles et je n’ai pas réécrit l’adaptation. »
Une fois ce transfert digéré, l’heure est à la réécriture. Il faut faire de la pièce un vrai scénario. Lourde tâche. Et Jean Poiret n’y parvient pas. Il sombre même dans une profonde dépression. Sur les conseils d’Édouard Molinaro, choisi pour la réalisation (le nom de Jean-Pierre Mocky avait aussi été évoqué), Marcello Danon appelle à la rescousse un maître de la plume, l’inestimable Francis Veber, à la carrière déjà plus qu’exceptionnelle (Le Grand Blond avec une chaussure noire, L’Emmerdeur, Le Téléphone rose, Peur sur la ville, Coup de tête, etc.). L’auteur comprend parfaitement le problème : « Il faut couper, attaquer la pièce à la hache, pour l’amener au format d’un film. Certaines situations dont on sait qu’elles sont drôles sont sacrifiées et les rires qu’elles ont provoqués sur scène viennent mourir dans la corbeille à papier. » Fervent admirateur de Poiret, Veber accepte immanquablement de relever le défi et y parvient haut la main, n’en déplaise à Danon qui, au bout du compte, estime qu’il n’y pas assez de femmes dans son script : « Il faisait partie de la vieille école de producteurs, explique Francis Veber, ceux qui pensaient que, pour assurer le succès d’un film, il fallait quelques filles déshabillées, un chien d’aveugle et un enfant abandonné. C’était trop difficile à caser dans La Cage aux folles et je n’ai pas réécrit l’adaptation. »
 Passer de la scène à l’écran s’avère être également un exercice complexe pour Michel Serrault. Après avoir été porté par les rires de plusieurs centaines de spectateurs, le comédien se retrouve dorénavant face à une équipe réduite et contrainte au silence le plus absolue. Mais il ne peut s’y résoudre : « Quand on tourne La Cage aux folles, si on n’a pas la moindre réaction en face, un début de sourire, on a l’impression de tomber à plat. Quand vous dialoguez sur le plateau en bas à résille, grimé comme un travesti, un chapeau sur la tête et un texte surréaliste dans la bouche, il vous faut l’échange avec le public. Comment va-t-il réagir ? Or vous êtes seul… Tragiquement seul ! Le réalisateur ne s’intéresse pas toujours à ce que vous faites. Les techniciens sont absorbés par leur travail. Finalement, je n’ai joué La Cage aux folles que pour l’opérateur, Armando Nannuzzi, face à moi. Il était attentif, réceptif, il riait beaucoup… et j’ai joué exclusivement pour lui. »
Passer de la scène à l’écran s’avère être également un exercice complexe pour Michel Serrault. Après avoir été porté par les rires de plusieurs centaines de spectateurs, le comédien se retrouve dorénavant face à une équipe réduite et contrainte au silence le plus absolue. Mais il ne peut s’y résoudre : « Quand on tourne La Cage aux folles, si on n’a pas la moindre réaction en face, un début de sourire, on a l’impression de tomber à plat. Quand vous dialoguez sur le plateau en bas à résille, grimé comme un travesti, un chapeau sur la tête et un texte surréaliste dans la bouche, il vous faut l’échange avec le public. Comment va-t-il réagir ? Or vous êtes seul… Tragiquement seul ! Le réalisateur ne s’intéresse pas toujours à ce que vous faites. Les techniciens sont absorbés par leur travail. Finalement, je n’ai joué La Cage aux folles que pour l’opérateur, Armando Nannuzzi, face à moi. Il était attentif, réceptif, il riait beaucoup… et j’ai joué exclusivement pour lui. »
L’artiste manque par ailleurs de repères. Tout du moins, aux premiers jours du tournage. Si on parle d’« adaptation », « La Cage aux folles – le film » se distingue en réalité vigoureusement de la pièce d’origine, comme le spécifie Édouard Molinaro : « Veber et moi avons voulu nous écarter de temps en temps du vaudeville pour faire sentir au spectateur le désarroi de cet étrange couple qui a tant de mal à assurer le bonheur de son enfant. Les réticences de Michel sont peut-être dues à ce choix. Serrault est un croyant sincère (nous avons gravi ensemble les centaines de marches du dôme de Saint-Pierre). Jouer les travestis délirants sur une scène ne lui a posé aucun problème. En revanche, incarner la fragilité douloureuse d’un homosexuel ordinaire lui est peut-être difficile. » Mais le génie et l’intelligence aidant, l’acteur s’accommode aisément de ces précieux changements. Il en perçoit surtout le sens et prend un plaisir infini à incarner cela. Par exemple, la scène où il se force à s’habiller en homme, revisitée par Veber, l’excite au plus haut point : « C’est un moment que j’adore, qui donne au personnage une vérité extraordinaire, une émotion, une profondeur. Et cela démontre que si l’auteur a du talent, si les acteurs croient à la vérité d’un personnage, alors on peut tout faire, y compris susciter l’émotion dans le comique. Vous riez ? Ne riez pas trop fort, parce que moi je vais vous montrer tout ce qu’on peut faire surgir d’émotion, ou de sentiment, là où il n’y avait en apparence que grosse rigolade et parodie. »
 Conjointement, l’ambiance générale n’est pas toujours au beau fixe. Ugo Tognazzi, star italienne choisie pour suppléer Jean Poiret, ne se révèle pas être un compagnon exemplaire. Principalement aux côtés de Molinaro, avec qui la tension est extrême. Il faut dire que le comédien ne fait aucun effort. Bien que s’étant engagé par contrat à parler français, il joue le personnage de Renato (ex-Georges) dans sa langue maternelle (il sera ensuite doublé par Pierre Mondy). Pire, il n’apprend pas son texte et improvise sans limite, quitte à être totalement hors sujet. Ce qui lui vaut de sérieuses remontrances de la part du réalisateur : « Un jour, je lui fait observer que sa façon de travailler n’est pas d’une orthodoxie parfaite et qu’il n’aide ni ses partenaires, ni son metteur en scène. Ugo entre dans une rage violente et hurle que, de toute façon, ce scénario est une merde (sic) et qu’il ne tournera pas la séquence prévue aujourd’hui. Hissant le geste à la parole du verbe, il s’empare du script, isole les trois pages du jour et les arrache d’un geste théâtral. Arrêt du tournage. Marcello, le producteur, regarde sa montre et appelle l’avocat de Tognazzi. Celui-ci explique à son client qu’il n’a déjà pas tenu ses engagements, qu’il valait mieux lire le script avant de toucher son premier chèque et que, s’il arrêtait le tournage, il aurait un dédit énorme à payer à la production. Arguments irréfutables. Ugo reprend le travail en grommelant, suivi par Michel, que la colère de son partenaire n’a pas mis dans les meilleures dispositions. Le tournage parviendra à son terme sans que jamais l’ambiance du plateau ne retrouve un semblant de sérénité. »
Conjointement, l’ambiance générale n’est pas toujours au beau fixe. Ugo Tognazzi, star italienne choisie pour suppléer Jean Poiret, ne se révèle pas être un compagnon exemplaire. Principalement aux côtés de Molinaro, avec qui la tension est extrême. Il faut dire que le comédien ne fait aucun effort. Bien que s’étant engagé par contrat à parler français, il joue le personnage de Renato (ex-Georges) dans sa langue maternelle (il sera ensuite doublé par Pierre Mondy). Pire, il n’apprend pas son texte et improvise sans limite, quitte à être totalement hors sujet. Ce qui lui vaut de sérieuses remontrances de la part du réalisateur : « Un jour, je lui fait observer que sa façon de travailler n’est pas d’une orthodoxie parfaite et qu’il n’aide ni ses partenaires, ni son metteur en scène. Ugo entre dans une rage violente et hurle que, de toute façon, ce scénario est une merde (sic) et qu’il ne tournera pas la séquence prévue aujourd’hui. Hissant le geste à la parole du verbe, il s’empare du script, isole les trois pages du jour et les arrache d’un geste théâtral. Arrêt du tournage. Marcello, le producteur, regarde sa montre et appelle l’avocat de Tognazzi. Celui-ci explique à son client qu’il n’a déjà pas tenu ses engagements, qu’il valait mieux lire le script avant de toucher son premier chèque et que, s’il arrêtait le tournage, il aurait un dédit énorme à payer à la production. Arguments irréfutables. Ugo reprend le travail en grommelant, suivi par Michel, que la colère de son partenaire n’a pas mis dans les meilleures dispositions. Le tournage parviendra à son terme sans que jamais l’ambiance du plateau ne retrouve un semblant de sérénité. »
 Pour ne rien arranger, le caractère d’Édouard Molinaro, peu rieur, plombe encore davantage les rapports humains. Et si l’homme se fait une joie de retravailler avec Serrault (après La Chasse à l’homme, en 1964), il admet volontiers que tourner ce genre de film ne l’anime pas outre mesure. Michel Galabru, invité lui aussi à participer à cette fantastique aventure (il revêt les frasques du député Simon Charrier), le ressent tout particulièrement : « Molinaro était d’une froideur terrible avec tout le monde, avec un caractère très difficile – nous, nous avions des rapports corrects sur le tournage, mais je sais qu’il ne m’aimait pas. Le chef opérateur, un autre Italien, l’a bien compris à ses dépens. Un jour, pris d’une furie soudaine, il s’est mis à pousser des cris. Il n’en finissait pas de vociférer. Devant lui, Édouard n’a rien dit, pas un seul mot. Quand il s’est calmé, Molinaro a fait comme s’il ne s’était rien rien passé : « Allez, enchaînons… Attention. Moteur ! » Le chef opérateur était scié. »
Pour ne rien arranger, le caractère d’Édouard Molinaro, peu rieur, plombe encore davantage les rapports humains. Et si l’homme se fait une joie de retravailler avec Serrault (après La Chasse à l’homme, en 1964), il admet volontiers que tourner ce genre de film ne l’anime pas outre mesure. Michel Galabru, invité lui aussi à participer à cette fantastique aventure (il revêt les frasques du député Simon Charrier), le ressent tout particulièrement : « Molinaro était d’une froideur terrible avec tout le monde, avec un caractère très difficile – nous, nous avions des rapports corrects sur le tournage, mais je sais qu’il ne m’aimait pas. Le chef opérateur, un autre Italien, l’a bien compris à ses dépens. Un jour, pris d’une furie soudaine, il s’est mis à pousser des cris. Il n’en finissait pas de vociférer. Devant lui, Édouard n’a rien dit, pas un seul mot. Quand il s’est calmé, Molinaro a fait comme s’il ne s’était rien rien passé : « Allez, enchaînons… Attention. Moteur ! » Le chef opérateur était scié. »
 À l’issue du tournage, une projection rigoureusement privée du film – dans une version brute, sans musique (composée ensuite par l’immense Ennio Morricone) ni doublage – est orchestrée. Édouard Molinaro y assiste, en présence du distributeur, de Francis Veber, ainsi que de Pierre Tchernia, fidèle complice – et conseiller sincère – de Serrault. Tous trépignent, excités de découvrir cette appropriation cinématographique. Mais la séance est redoutable : « Je me tasse dans mon fauteuil, déplore encore trente ans après Molinaro au sein de ses mémoires. Je suis effondré. Rien, dans cette histoire, ne m’amuse. Je trouve la mise en scène d’un académisme navrant. Je ne perçois même pas la folie inventive de Serrault, pas plus que l’élégance de la photographie d’Armando Nannuzzi. Quand la lumière se rallume, je constate que mon avis est partagé. Francis mène la charge, principalement dirigée contre le metteur en scène. Je ne suis pas loin d’être de son avis. » Seul Tchernia conserve un soupçon d’optimisme. Pour lui, le résultat n’est absolument pas catastrophique. Le long-métrage pourrait même obtenir un bel écho populaire. L’avenir lui donne largement raison, puisque La Cage aux folles, dont la sortie en France est prévue le 25 octobre 1978, fera, non pas un simple « succès », mais un véritable raz-de-marée ! 5.406.614 spectateurs tombent sous le charme de cet irrésistible couple, à la fois drôle et touchant. Et la conquête ne s’arrête pas là. Le film voyage évidemment jusqu’en Italie (cinq jours avant son exploitation dans l’hexagone, pour un cumul de 6.600.000 entrées), en Allemagne (2.650.000), en Hongrie, au Danemark, en Finlande, en Espagne, au Pays-Bas, en Suède, au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada, au Brésil, en Uruguay, au Japon, en Australie… sans oublier un passage par les États-Unis, où le film réussit l’exploit de vendre 8.137.200 tickets (soit plus de vingt millions de dollars de recettes). Jusqu’en 1998, il s’agira même du film en langue étrangère le plus vu sur ces territoires ! Un sacré record.
À l’issue du tournage, une projection rigoureusement privée du film – dans une version brute, sans musique (composée ensuite par l’immense Ennio Morricone) ni doublage – est orchestrée. Édouard Molinaro y assiste, en présence du distributeur, de Francis Veber, ainsi que de Pierre Tchernia, fidèle complice – et conseiller sincère – de Serrault. Tous trépignent, excités de découvrir cette appropriation cinématographique. Mais la séance est redoutable : « Je me tasse dans mon fauteuil, déplore encore trente ans après Molinaro au sein de ses mémoires. Je suis effondré. Rien, dans cette histoire, ne m’amuse. Je trouve la mise en scène d’un académisme navrant. Je ne perçois même pas la folie inventive de Serrault, pas plus que l’élégance de la photographie d’Armando Nannuzzi. Quand la lumière se rallume, je constate que mon avis est partagé. Francis mène la charge, principalement dirigée contre le metteur en scène. Je ne suis pas loin d’être de son avis. » Seul Tchernia conserve un soupçon d’optimisme. Pour lui, le résultat n’est absolument pas catastrophique. Le long-métrage pourrait même obtenir un bel écho populaire. L’avenir lui donne largement raison, puisque La Cage aux folles, dont la sortie en France est prévue le 25 octobre 1978, fera, non pas un simple « succès », mais un véritable raz-de-marée ! 5.406.614 spectateurs tombent sous le charme de cet irrésistible couple, à la fois drôle et touchant. Et la conquête ne s’arrête pas là. Le film voyage évidemment jusqu’en Italie (cinq jours avant son exploitation dans l’hexagone, pour un cumul de 6.600.000 entrées), en Allemagne (2.650.000), en Hongrie, au Danemark, en Finlande, en Espagne, au Pays-Bas, en Suède, au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada, au Brésil, en Uruguay, au Japon, en Australie… sans oublier un passage par les États-Unis, où le film réussit l’exploit de vendre 8.137.200 tickets (soit plus de vingt millions de dollars de recettes). Jusqu’en 1998, il s’agira même du film en langue étrangère le plus vu sur ces territoires ! Un sacré record.
Le 3 février 1979, lors de la quatrième Nuit des César, le long-métrage n’est curieusement cité qu’une seule fois, au travers de la catégorie « Meilleur Acteur » pour Michel Serrault, qui remporte – sans surprise – le prix, face à Claude Brasseur, Gérard Depardieu, Jean Carmet, et ne boude pas son plaisir : « Je n’ai jamais couru après les récompenses. Mais pourquoi cacherais-je la principale raison qui me rendit fou de joie de recevoir ce César ? Il s’agissait d’un rôle comique, et, pour la première fois, on me disait que j’avais été un bon clown. » Hasard des calendriers, cette année-là le nom de Serrault figure également au sein de la catégorie « Meilleur Second rôle » pour une prestation – encore remarquable – dans L’Argent des autres de Christian de Chalonge. Mais, point de doublet.
 Quelques mois plus tard, c’est au tour de l’Académie du cinéma italien de saluer sa prestation, en lui décernant le Donatello du « Meilleur Acteur étranger », ex-aequo avec Richard Gere (pour Les Moissons du ciel de Terrence Malick). Quant au long-métrage, il décroche en 1983 le Golden Globe du « Meilleur Film étranger », puis trois nominations aux Oscars (« Meilleur Réalisateur », « Meilleure Adaptation », « Meilleurs Costumes »). Rien que ça.
Quelques mois plus tard, c’est au tour de l’Académie du cinéma italien de saluer sa prestation, en lui décernant le Donatello du « Meilleur Acteur étranger », ex-aequo avec Richard Gere (pour Les Moissons du ciel de Terrence Malick). Quant au long-métrage, il décroche en 1983 le Golden Globe du « Meilleur Film étranger », puis trois nominations aux Oscars (« Meilleur Réalisateur », « Meilleure Adaptation », « Meilleurs Costumes »). Rien que ça.
La Cage aux folles II (Édouard Molinaro, 1980)
 Une telle consécration enflamme les principaux intéressés et, sans tarder, une Cage aux folles II est commanditée. Danon veut battre le fer tant qu’il est chaud. Par chance, Jean Poiret, requinqué par la nouvelle envolée de sa Cage, se montre tout aussi enthousiaste. De fait, celui-ci s’associe à présent pleinement avec Francis Veber pour imaginer une histoire originale. Et les deux hommes s’isolent dans un studio au cœur de La Baule, où la cohabitation s’avère idyllique : « Quand nous avions fini une scène, révèle Veber, il la jouait, interprétant les rôles des deux folles. Je le voyais passer des glapissements hystériques de Zaza Napoli à l’accablement de son « mari » Renato, et je ne me suis jamais autant amusé à écrire un script. Mais quand je pensais être seul à profiter de la performance de Poiret, je me trompais. Les murs du studio étaient tellement minces qu’il jouait sans le savoir pour tout l’immeuble (…) Quand nous sortions pour prendre l’air après une séance de travail, les gens « normaux » se postaient à leurs balcons pour nous observer. Ils voyaient un homme à cheveux gris qui s’éloignait vers la plage avec un type plus jeune et un peu louche – moi – et j’ai clairement entendu une fois le commentaire d’un des voisins : « Ce sont les pédés du cinquième. » » Sitôt le scénario de La Cage aux folles II achevé – mélange de comédie et d’aventure –, on prend les mêmes (ou presque) et on recommence. Michel Serrault et Ugo Tognazzi au premier plan mènent la barque, Michel Galabru tout comme Benny Luke ne font plus que passer, tandis que de nouvelles têtes font leur entrée dans la cage, à l’instar de Marcel Bozzuffi, en chef du contre-espionnage, de Paola Borboni (sommité ayant débuté dans le cinéma muet), ici mère de Renato, ou de Glauco Onorato (connu pour être la voix italienne d’Arnold Schwarzenegger, de Danny Glover et de Charles Bronson), dans le rôle d’un séduisant berger.
Une telle consécration enflamme les principaux intéressés et, sans tarder, une Cage aux folles II est commanditée. Danon veut battre le fer tant qu’il est chaud. Par chance, Jean Poiret, requinqué par la nouvelle envolée de sa Cage, se montre tout aussi enthousiaste. De fait, celui-ci s’associe à présent pleinement avec Francis Veber pour imaginer une histoire originale. Et les deux hommes s’isolent dans un studio au cœur de La Baule, où la cohabitation s’avère idyllique : « Quand nous avions fini une scène, révèle Veber, il la jouait, interprétant les rôles des deux folles. Je le voyais passer des glapissements hystériques de Zaza Napoli à l’accablement de son « mari » Renato, et je ne me suis jamais autant amusé à écrire un script. Mais quand je pensais être seul à profiter de la performance de Poiret, je me trompais. Les murs du studio étaient tellement minces qu’il jouait sans le savoir pour tout l’immeuble (…) Quand nous sortions pour prendre l’air après une séance de travail, les gens « normaux » se postaient à leurs balcons pour nous observer. Ils voyaient un homme à cheveux gris qui s’éloignait vers la plage avec un type plus jeune et un peu louche – moi – et j’ai clairement entendu une fois le commentaire d’un des voisins : « Ce sont les pédés du cinquième. » » Sitôt le scénario de La Cage aux folles II achevé – mélange de comédie et d’aventure –, on prend les mêmes (ou presque) et on recommence. Michel Serrault et Ugo Tognazzi au premier plan mènent la barque, Michel Galabru tout comme Benny Luke ne font plus que passer, tandis que de nouvelles têtes font leur entrée dans la cage, à l’instar de Marcel Bozzuffi, en chef du contre-espionnage, de Paola Borboni (sommité ayant débuté dans le cinéma muet), ici mère de Renato, ou de Glauco Onorato (connu pour être la voix italienne d’Arnold Schwarzenegger, de Danny Glover et de Charles Bronson), dans le rôle d’un séduisant berger.
 À la différence de son prédécesseur, ce tournage commence sous de joyeux auspices. Serrault, emballé par le script, se jette à corps perdu dans cette seconde folie : « Il y avait de belles trouvailles, de bons moments à jouer. J’avais une longue tirade devant ma coiffeuse, où, en pleurs, je faisais un bilan amer de mon existence et de l’ingratitude des mâles : « Aucun homme n’a autant travaillé que moi pour se payer ses robes ! » sanglotais-je. Molinaro l’avait tournée en un plan-séquence de plusieurs minutes, qui me permettait de jouer la scène dans toute sa continuité. J’apercevais le buste d’Armando Nannuzzi secoué par le rire. J’apportai au personnage à la fois des traits burlesques (Zaza, penchée à la fenêtre du train, hurle d’arrêter le convoi en faisant « tut tut ! » comme dans une locomotive à vapeur), et des notes émouvantes (face au berger amoureux d’elle : « Je n’ai rien de plus que les autres, croyez moi. Simplement le charme de la nouveauté… »). »
À la différence de son prédécesseur, ce tournage commence sous de joyeux auspices. Serrault, emballé par le script, se jette à corps perdu dans cette seconde folie : « Il y avait de belles trouvailles, de bons moments à jouer. J’avais une longue tirade devant ma coiffeuse, où, en pleurs, je faisais un bilan amer de mon existence et de l’ingratitude des mâles : « Aucun homme n’a autant travaillé que moi pour se payer ses robes ! » sanglotais-je. Molinaro l’avait tournée en un plan-séquence de plusieurs minutes, qui me permettait de jouer la scène dans toute sa continuité. J’apercevais le buste d’Armando Nannuzzi secoué par le rire. J’apportai au personnage à la fois des traits burlesques (Zaza, penchée à la fenêtre du train, hurle d’arrêter le convoi en faisant « tut tut ! » comme dans une locomotive à vapeur), et des notes émouvantes (face au berger amoureux d’elle : « Je n’ai rien de plus que les autres, croyez moi. Simplement le charme de la nouveauté… »). »
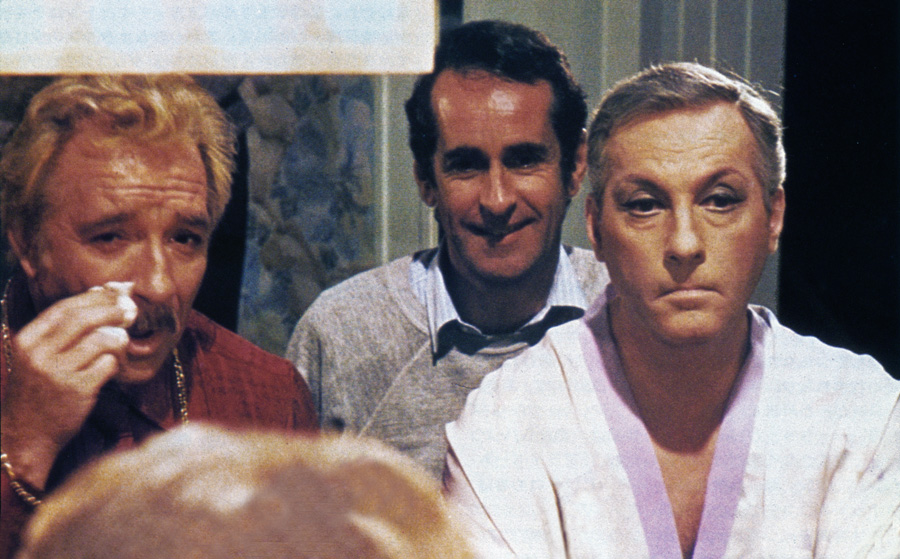 Tognazzi se montre quant à lui beaucoup plus respectueux qu’auparavant. Un changement de tempérament dont est responsable Francis Veber. En amont des prises de vue, l’auteur, accompagné d’Édouard Molinaro, apporte à l’acteur le scénario en vue d’une lecture : « Nous nous sommes assis, script en main, autour d’une table et Tognazzi, au lieu de s’intéresser à son personnage, préféra reprendre son rôle de bourreau. Il se mit à éructer des critiques incompréhensibles et j’ai vu le moment où il allait s’attraper les couilles à pleines mains. Molinaro qui avait repris, lui, son rôle de dominé, se recroquevillait sur sa chaise. Si les remarques de Tognazzi avaient été justifiées, je ne serais pas intervenu, mais comme elles n’étaient fondées que sur ses rapports sado-maso avec Molinaro, je me suis énervé, avec une véhémence qui m’a surpris moi-même : « Ugo, tout ce que tu racontes est très con et il faut arrêter d’emmerder Molinaro, maintenant ! Aucun film ne t’a apporté autant que cette Cage, alors, fais ton métier et fous-nous la paix ! » On a repris la lecture et Tognazzi n’a plus ouvert la bouche. Il me jetait de temps en temps des regards en coin. À un moment donné, je suis allé dans la salle de bains et Molinaro m’a raconté qu’après mon départ Tognazzi s’était adressé à lui à voix basse : « Dis-lui de ne pas me parler sur ce ton, moi je n’ose pas le faire parce que je suis italien, donc très lâche. »
Tognazzi se montre quant à lui beaucoup plus respectueux qu’auparavant. Un changement de tempérament dont est responsable Francis Veber. En amont des prises de vue, l’auteur, accompagné d’Édouard Molinaro, apporte à l’acteur le scénario en vue d’une lecture : « Nous nous sommes assis, script en main, autour d’une table et Tognazzi, au lieu de s’intéresser à son personnage, préféra reprendre son rôle de bourreau. Il se mit à éructer des critiques incompréhensibles et j’ai vu le moment où il allait s’attraper les couilles à pleines mains. Molinaro qui avait repris, lui, son rôle de dominé, se recroquevillait sur sa chaise. Si les remarques de Tognazzi avaient été justifiées, je ne serais pas intervenu, mais comme elles n’étaient fondées que sur ses rapports sado-maso avec Molinaro, je me suis énervé, avec une véhémence qui m’a surpris moi-même : « Ugo, tout ce que tu racontes est très con et il faut arrêter d’emmerder Molinaro, maintenant ! Aucun film ne t’a apporté autant que cette Cage, alors, fais ton métier et fous-nous la paix ! » On a repris la lecture et Tognazzi n’a plus ouvert la bouche. Il me jetait de temps en temps des regards en coin. À un moment donné, je suis allé dans la salle de bains et Molinaro m’a raconté qu’après mon départ Tognazzi s’était adressé à lui à voix basse : « Dis-lui de ne pas me parler sur ce ton, moi je n’ose pas le faire parce que je suis italien, donc très lâche. »
 À l’arrivée, le retour de Zaza Napoli et de son conjoint Renato enchante (une fois de plus) les foules, puisqu’en France 3.015.152 spectateurs se ruent dans les salles obscures. Un score certes en-deçà du précédent, néanmoins considérable. Et ce n’est pas tout. Outre-Rhin, entre autres, on comptabilise plus d’un million de tickets vendus, et au pays de l’Oncle Sam les recettes s’élèvent à 6.950.125 dollars. Plus incroyable encore, Michel Serrault décroche en 1981 une nouvelle nomination aux César, catégorie « Meilleur Acteur », pour le même rôle (!). Une première – et dernière ? – dans l’Histoire.
À l’arrivée, le retour de Zaza Napoli et de son conjoint Renato enchante (une fois de plus) les foules, puisqu’en France 3.015.152 spectateurs se ruent dans les salles obscures. Un score certes en-deçà du précédent, néanmoins considérable. Et ce n’est pas tout. Outre-Rhin, entre autres, on comptabilise plus d’un million de tickets vendus, et au pays de l’Oncle Sam les recettes s’élèvent à 6.950.125 dollars. Plus incroyable encore, Michel Serrault décroche en 1981 une nouvelle nomination aux César, catégorie « Meilleur Acteur », pour le même rôle (!). Une première – et dernière ? – dans l’Histoire.
La Cage aux folles III : “elles” se marient (Georges Lautner, 1985)
Comment, dès lors, résister à l’appel d’un troisième volet ? Le producteur Marcello Danon est convaincu par la nécessité (pécuniaire ?) de poursuivre la série. Mais il ne parvient pas à mobiliser l’entièreté de la troupe. À commencer par Jean Poiret, qui ne souhaite vraiment pas participer au développement d’un énième long-métrage. Idem pour Édouard Molinaro. Voilà pourquoi Danon se voit contraint de renouveler son équipe. Le sujet de La Cage aux folles III : “elles” se marient est ainsi imaginé par Philippe Nicaud et Anne Carrère, célèbre couple de comédiens, et les dialogues par Michel Audiard (son fils, Jacques, participe aussi à l’adaptation du script). De leur travail commun, résulte l’intrigue suivante : afin de toucher un héritage, Albin a pour obligation d’être marié, et avoir un enfant légitime avec son épouse, qui plus est dans un délai de dix-huit mois dès l’ouverture du testament. Renato, en proie à d’importantes difficultés financières avec La Cage au folles, voit là l’occasion de sauver leur situation…
 La mise en scène de cet opus est désormais confiée à Georges Lautner. Après avoir adapté une autre pièce – des plus fameuses – échafaudée par Jean Poiret (Joyeuses Pâques en 1984, avec Jean-Paul Belmondo, Sophie Marceau et Marie Laforêt), le cinéaste apparaît comme un choix évident, et c’est avec bonheur qu’il se rallie à cette folle saga : « J’ai toujours fait mien un proverbe marseillais que me répétait mon ami René Brun, directeur de production aux studios de la Victorine : « Georges, quand passent les alouettes, il ne faut pas manquer de cartouches. » Quand on m’a proposé La Cage aux folles III, je n’ai pas hésité, j’ai dégainé. Le premier film de la série était directement tiré de la pièce de Jean Poiret, c’était merveilleux. Le deuxième était déjà tiré par les cheveux. Le troisième est une déconnade totale ! Le grand luxe dans le domaine de la pitrerie ! Et avoir la possibilité de filmer Serrault volant dans le ciel déguisé en abeille, ça ne se rate pas ! »
La mise en scène de cet opus est désormais confiée à Georges Lautner. Après avoir adapté une autre pièce – des plus fameuses – échafaudée par Jean Poiret (Joyeuses Pâques en 1984, avec Jean-Paul Belmondo, Sophie Marceau et Marie Laforêt), le cinéaste apparaît comme un choix évident, et c’est avec bonheur qu’il se rallie à cette folle saga : « J’ai toujours fait mien un proverbe marseillais que me répétait mon ami René Brun, directeur de production aux studios de la Victorine : « Georges, quand passent les alouettes, il ne faut pas manquer de cartouches. » Quand on m’a proposé La Cage aux folles III, je n’ai pas hésité, j’ai dégainé. Le premier film de la série était directement tiré de la pièce de Jean Poiret, c’était merveilleux. Le deuxième était déjà tiré par les cheveux. Le troisième est une déconnade totale ! Le grand luxe dans le domaine de la pitrerie ! Et avoir la possibilité de filmer Serrault volant dans le ciel déguisé en abeille, ça ne se rate pas ! »
 Entre le réalisateur des Tontons Flingueurs et l’interprète de Zaza Napoli, il s’agit avant tout d’heureuses retrouvailles (les deux hommes ont travaillé ensemble sur le film Des Pissenlits par la racine en 1963). A contrario, pour le cinéaste, Ugo Tognazzi est une découverte totale, et il doit – après Molinaro – se confronter au caractère bien trempé de la vedette : « Si son rôle était joli, précise Lautner, il restait néanmoins celui d’un faire-valoir. Il cherchait pourtant constamment à tirer la couverture à lui, improvisant sans cesse des dialogues, des scènes… D’autant plus que Serrault m’avait averti de la propension de son partenaire à partir en délire. Tout en me prévenant : « Je ne veux pas d’histoires avec Tognazzi. Si ça ne colle pas entre vous, je serai de son côté… » J’ai donc décidé de n’avoir aucun problème avec Tognazzi. Je l’ai laissé rajouter des dialogues, improviser à tout bout de champ. J’ai tout filmé. Et j’ai coupé au montage ce qui n’était pas utile. »
Entre le réalisateur des Tontons Flingueurs et l’interprète de Zaza Napoli, il s’agit avant tout d’heureuses retrouvailles (les deux hommes ont travaillé ensemble sur le film Des Pissenlits par la racine en 1963). A contrario, pour le cinéaste, Ugo Tognazzi est une découverte totale, et il doit – après Molinaro – se confronter au caractère bien trempé de la vedette : « Si son rôle était joli, précise Lautner, il restait néanmoins celui d’un faire-valoir. Il cherchait pourtant constamment à tirer la couverture à lui, improvisant sans cesse des dialogues, des scènes… D’autant plus que Serrault m’avait averti de la propension de son partenaire à partir en délire. Tout en me prévenant : « Je ne veux pas d’histoires avec Tognazzi. Si ça ne colle pas entre vous, je serai de son côté… » J’ai donc décidé de n’avoir aucun problème avec Tognazzi. Je l’ai laissé rajouter des dialogues, improviser à tout bout de champ. J’ai tout filmé. Et j’ai coupé au montage ce qui n’était pas utile. »
 Si le scénario manque globalement de corps, la drôlerie demeure et les comédiens – Serrault en tête – assurent largement le spectacle. On ne s’ennuie pas un instant, pourtant le public français ne se mobilise guère autour de cette ultime resucée (1.693.202 entrées seulement). Et ce n’est pas mieux à l’étranger : 172.537 spectateurs en Allemagne, 345.280 $ de recettes aux États-Unis. Une chute cruelle, qui conduit logiquement à la fermeture irrévocable de La Cage. Michel Galabru témoigne : « De notre point de vue d’acteurs, nous tournions dans de très bonnes conditions, avec les plus beaux hôtels et de très bons cachets. Serrault, Tognazzi ou moi-même ne regardions pas la qualité du scénario. Si l’argent avait continué à entrer, nous aurions sûrement fait une Cage aux folles IV.
Si le scénario manque globalement de corps, la drôlerie demeure et les comédiens – Serrault en tête – assurent largement le spectacle. On ne s’ennuie pas un instant, pourtant le public français ne se mobilise guère autour de cette ultime resucée (1.693.202 entrées seulement). Et ce n’est pas mieux à l’étranger : 172.537 spectateurs en Allemagne, 345.280 $ de recettes aux États-Unis. Une chute cruelle, qui conduit logiquement à la fermeture irrévocable de La Cage. Michel Galabru témoigne : « De notre point de vue d’acteurs, nous tournions dans de très bonnes conditions, avec les plus beaux hôtels et de très bons cachets. Serrault, Tognazzi ou moi-même ne regardions pas la qualité du scénario. Si l’argent avait continué à entrer, nous aurions sûrement fait une Cage aux folles IV.
Le pognon était roi. À croire que le troisième épisode n’a sans doute pas rapporté suffisamment… »
Fin du spectacle ? Pas tout à fait. À l’approche des années 1990, un retour au théâtre se profile. Jean Poiret le confirme à Pierre Mondy : « Michel est d’accord pour rejouer la pièce. Faisons cent représentations exceptionnelles et filmons-en une. On est tous les trois producteurs et on exploitera la VHS… » Un véritable événement. Poiret et Serrault s’apprêtent ainsi à célébrer leur quarante ans de carrière (ils ont débuté en 1953 au Tabou) et, au passage, les « vingt tantes » (dixit Jean) de La Cage aux folles. Mais le destin, souvent intraitable, s’y oppose, la disparition de Poiret le 14 mars 1992 mettant un terme forcé au projet.
 Depuis, la pièce a connu diverses résurrections (notamment en 2009 avec Christian Clavier et Didier Bourdon, sous la direction de Didier Caron), son adaptation en comédie musicale (à partir d’un livret signé Harvey Fierstein et une musique de Jerry Herman) s’est exportée à travers le monde dès le milieu des années 1980, et un remake cinématographique dirigé par Mike Nichols, The Birdcage, a vu le jour outre-Atlantique en 1996, avec Robin Williams, Nathan Lane, Gene Hackman, Dianne Wiest et Hank Azaria (passé inaperçu en France, le film rencontra un succès retentissant aux États-Unis, rapportant 185.186.682$ pour un budget de 43 millions). Une version vietnamienne, intitulée Ngoi Nha Buom Buom (Huynh Tuan Anh, 2019), est également à signaler.
Depuis, la pièce a connu diverses résurrections (notamment en 2009 avec Christian Clavier et Didier Bourdon, sous la direction de Didier Caron), son adaptation en comédie musicale (à partir d’un livret signé Harvey Fierstein et une musique de Jerry Herman) s’est exportée à travers le monde dès le milieu des années 1980, et un remake cinématographique dirigé par Mike Nichols, The Birdcage, a vu le jour outre-Atlantique en 1996, avec Robin Williams, Nathan Lane, Gene Hackman, Dianne Wiest et Hank Azaria (passé inaperçu en France, le film rencontra un succès retentissant aux États-Unis, rapportant 185.186.682$ pour un budget de 43 millions). Une version vietnamienne, intitulée Ngoi Nha Buom Buom (Huynh Tuan Anh, 2019), est également à signaler.
Il n’empêche, au fil des ans, seul le nom de Jean Poiret et, plus encore, celui de Michel Serrault, subsistent véritablement. En 2002, ce dernier s’interrogeait : « Qui aurait pu prévoir que cette Cage allait devenir un des plus grands triomphes qu’ait connus la scène française ? « La pièce du siècle » iront jusqu’à dire certains. Parmi ceux qui l’ont vue, il en est toujours qui trouvent des accents héroïques pour en parler : “J’y étais !” »
par Gilles Botineau
Sources
Le Cri de la carotte de Michel Serrault, conversations avec Jean-Louis Remilleux – (Michel Lafon, 1995)
…Vous avez dit Serrault ? de Michel Serrault (Editions Florent Massot, 2002)
L’Ami Poiret (Éditions Noesis, 2002)
Jean Poiret de Philippe Durant (First document, 2015)
La Cage aux souvenirs de Pierre Mondy (Plon, 2006)
Trois petits tours et puis s’en vont… de Michel Galabru (Flammarion, 2002)
Les Rôles de ma vie de Michel Galabru, avec Alexandre Raveleau – (Hors Collection, 2016)
Intérieur soir de Édouard Molinaro (Anne Carrière, 2009)
On aura tout vu de Georges Lautner (Flammarion, 2005)
Que ça reste entre nous de Francis Veber (Robert Laffont, 2010)
Merci Zaza, la folle histoire de La Cage aux folles de Christophe Duchiron (Production INA)
 CineComedies
CineComedies